
Un Travail d'émotion
Crédits
Un Travail d'émotion
D'après l'article de Rose Hackman
Création et installation - Daniel Monino
Pour La Journées Internationales du Droit des Femmes 2017
lors de l'évènement Femmes d'exception à l'Hotel Mercure Centre Montpellier
Durée - indéterminée
Production - Festival Théâtre en Liberté
Co-Production - Hotel Mercure Centre Montpellier
Création le 27 mars 2017, dans la chambre 434 de l'Hotel Mercure Centre Montpellier
A propos
Cette installation a été pensée pour la Journée Internationale des droits des femmes 2017 à l’Hotel Mercure Centre à Montpellier. J’y accueillais les spectateurs en leur confiant une boîte contenant la carte d’accès d’une chambre, des instructions et un masque.
Une fois arrivé dans la chambre, les spectateurs pouvaient y rester le temps qu’ils voulaient et profiter des installations de l’hôtel. Ils pouvaient y lire plusieurs textes autour du travail émotionnel, et laisser des messages à l’attention des autres spectateurs ou à la mienne.
Le soir j’ai dormi dans la chambre et ai recueilli les messages pour en faire une oeuvre qui a été exposée à l’hôtel Mercure Centre.
« Les femmes savent juste mieux le faire » :
le travail émotionnel est-il la prochaine frontière du féminisme ?
Traduction d’un article de Rose Hackman publié sur The Guardian le 8 novembre 2015.
***
Se souvenir des anniversaires, offrir un service avec un sourire… la vie présente une couche de responsabilités quotidiennes dont on discute rarement - et qui se tombe de manière disproportionnée sous la responsabilité des femmes. Enfin confronter cela serait une étape révolutionnaire.
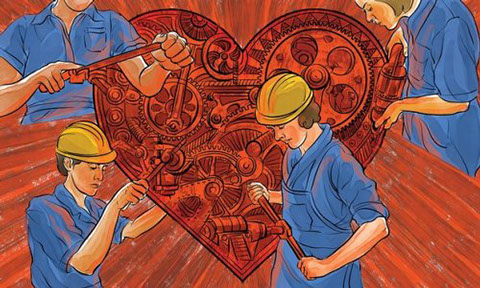
Femmes au travail : ce n’est que récemment que le travail émotionnel a lentement commencé à ré-émerger dans la culture populaire. Image > Chloe Cushman pour The Guardian
On se souvient des allergies des enfants, on écrit la liste de courses, on sait où est le double des clefs. On fait plusieurs choses à la fois. On sait quand il n’y a presque plus de coton-tiges, et on prévoit d’en acheter plus. On sait juste mieux se souvenir des anniversaires. On adore répondre aux besoin de nos proches, et on note ce qu’iels aiment manger. On remarque l’état de santé des gens, et on force nos ami.e.s et notre famille à aller chez le.a médecin.
On écoute les malheurs de notre partenaire, on lui pardonne les absences, les oublis, la pensée unique tandis qu’on est occupées à organiser un moment de jeu pour les enfants et leurs copaines. On applaudit le succès quand il arrive : quand la subvention a été reçue, la promotion obtenue. C’était leur accomplissement, et le nôtre en arrière-plan. En outre, si on travaille assez, on peut nous aussi réussir : on doit juste apprendre à se mettre en avant.
Et si, comme la garde des enfants et les travaux ménagers, la somme de tout ce travail émotionnel n’était qu’une autre forme de travail non-payé ?
Si vous pensez que j’exagère, vous avez tort. Le concept de travail émotionnel et de labeur émotionnel - comme vu plus haut, des actes ardus de performance genrée qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur - est un champ de recherche sérieux au sein des sciences sociales, et ce depuis des décennies.
Ça nous a juste pris un peu de temps pour être à la page.
***
Jennifer Lena, une sociologue et professeure de management de l’art à l’Université de Columbia, me fixe de l’autre côté de la table de café en bois. Nos deux bières sont entre nous, prêtes à être consommées.
Cependant, Lena ne boit pas. Elle me regarde juste, d’un air un peu déçu et tout simplement un peu blasé.
« Ton prochain papier est sur le travail émotionnel en tant que prochaine frontière du féminisme ? » répète-t-elle. « Mais c’est un sujet de sociologie tellement basique ! Je l’apprends à mes élèves de premier cycle depuis des années. »
Je prends une gorgée de ma bière tout en marmonnant des excuses.
Pour être juste, le rejet amical de Lena met en lumière un point pertinent. Le concept existe depuis plus de 30 ans ; il a d’abord été introduit par Arlie Hochschild, une universitaire qui a formellement inventé le concept dans son book The Managed Heart en 1983.
Mais c’est seulement récemment qu’il a lentement commencé à re-émerger dans des débats en ligne et dans la pop culture. Jess Zimmerman, qui a écrit sur le travail émotionnel dans The Toast, dit qu’elle a été soufflée par la quantité de retours qu’elle a reçus - des centaines et des centaines de femmes ont commenté en approuvant avec ferveur, la remerciant de leur donner enfin un vocabulaire pour ce qu’elles vivaient.
Zimmerman a décrit le travail émotionnel comme une chose se déroulant surtout en privé, tandis que les universitaires se sont d’abord concentré.es sur le sujet en tant que problème formel dans le milieu du travail. C’est peut-être parce que de plus en plus de femmes ont des professions ayant été dominées par des hommes qu’elles se rendent compte que ce travail supplémentaire émotionnel - disons « de femmes » - était attendu d’elles.

Hôtesse de l’Air : un des emplois qui exigent une immense patience.
Dans le monde du travail, le travail émotionnel se réfère au fait qu’on attende d’une travailleuse qu’elle manipule soit ses sentiments réels soit l’apparence de ses sentiments afin de satisfaire les exigences apparentes de son travail. Le travail émotionnel concerne également le fait d’attendre d’une travailleuse qu’elle ajuste ses sentiments afin d’influencer l’expérience positive d’un.e client.e ou collègue.
Cela inclut également : influencer l’harmonie du bureau, être agréable, présente mais pas trop, charmante et tolérante et se montrant volontaire pour des tâches subalternes (comme faire du café ou imprimer des documents).
Pensez aux hôtesses de l’air, qui étaient un des exemples principaux de Hochschild en 1983, devant répondre aux besoins des clients avec un sourire accommodant et une oreille sympathique, peu importe à quel point elles sont fatiguées ou dégoûtées par un enfant vomissant ou un client glauque de la classe affaires.
Pensez aussi aux femmes politiques, dont on attend qu’elles soient sympathiques et amusantes autant qu’intelligentes et capables (si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que les assistant.e.s d’Hillary Clinton la pressent de montrer un peu d’humour et de coeur).
Pensez à votre barista à Starbucks, qui a dessiné un smiley sur votre gobelet en carton ce matin. Voulait-elle vraiment sourire en extra aujourd’hui, ou était-ce juste ce qu’on attend d’elle au travail ?
***
Après quelques gorgées de bière, Lena, la sociologue, m’aide un peu.
« Voici la manière dont je considère le travail émotionnel : il y a certains travaux qui sont une exigence, où il n’y a pas d’accès à une formation, et où il y a un préjugé positif envers certaines personnes - les femmes - pour qu’elles le fassent. C’est aussi un type de travail qui est dénigré par la société en général. »
La recherche suggère que cumulativement, travailler émotionnellement de manière continue est épuisant mais rarement reconnu comme un effort légitime - et de ce fait, n’est pas reconnu dans les salaires.
Le développement d’emplois à bas salaires, dans l’industrie du service, où « le service avec un sourire » est une attente, a aidé à pérenniser encore plus le phénomène. Ici, le travail émotionnel n’est pas une valeur ajoutée ; c’est plutôt une exigence pour que les travailleureuses obtiennent le minimum vital.
Ça se manifeste encore plus aux Etats-Unis, où le salaire minimum fédéral où l’on peut recevoir un pourboire est de 2,13$ de l’heure. L’employeur.euse attend des personnes qui occupent ces emplois une production émotionnelle, mais ne veut pas payer cette production. La responsabilité de reconnaître ce travail émotionnel est déchargée sur lae client.e - qui s’attend donc à être comblé.e et satisfait.e émotionnellement avant de donner l’argent supplémentaire.
Ça a des conséquences néfastes, surtout pour les femmes. Selon une étude faite par ROC United, un centre de travailleur.euses représentant les employé.es du secteur de la restauration, les femmes vivant de pourboires dans les Etats qui ont pour salaire minimum 2,13$ sont deux fois plus susceptibles de faire l’expérience du harcèlement sexuel au travail que celles qui vivent dans des Etats où le salaire minimum est plus élevé.
Des données récentes indiquent qu’au moins les deux tiers des employé.es des industries à bas salaire sont des femmes, et la moitié de ces travailleuses sont racisées.
Même dans des industries plus prestigieuses, Jessica Collet, une professeure en sociologie à l’Université de Notre Dame, explique que les hommes et les femmes peuvent être engagé.es formellement dans le même niveau de travail émotionnel, mais on attend des femmes qu’elles apportent un travail émotionnel supplémentaire à côté.
Par exemple, les membres de la salle du conseil - hommes et femmes - peuvent devoir faire du relationnel avec les client de la même manière (une attente formelle qui va avec leur emploi) mais on peut attendre des femmes, en plus de ça, qu’elles contribuent à l’harmonie du bureau en se souvenant des anniversaires de leurs collègues, ou en bavardant avec le personnel. Les collègues masculins peuvent faire ça aussi, mais ça sera souvent remarqué comme un plus (« Il est toujours gentil et généreux n’est-ce pas ? »).
Cette remarque a été répétée par une brillante avocate spécialisée dans les droits humains, une amie à moi, qui s'est récemment plainte du fait qu’on attende d’elle qu’elle discute avec le personnel administratif du bureau chaque matin - quelque chose qu’elle était heureuse de faire, mais qu’elle avait aussi l’impression de devoir faire. Elle avait besoin d’être vue comme gentille et compétente pour être respectée, une chose dont ses collègues masculins n’avaient pas à s’inquiéter.
Robin Simon, une professeure de sociologie à Wake Forest University, a réfléchi en inversant les rôles et a dit qu’en tant que professeurE, on attendait d’elle qu’elle soit bien plus consciente sur le plan émotif et plus disponible à l'intérieur comme à l'extérieur de la salle de classe que ses collègues masculins.
« Les étudiant.es attendent plus d’émotion de la part des femmes », dit-elle, les professeurEs devant non seulement être enjouées dans la salle de classe (surtout avec l’évaluation des professeur.es par les étudiant.es), mais aussi parfois jouant le rôle de thérapeutes et de médiatrices des conflits liés à la politique de l’université.
***

« Je ne comprends pas vraiment. Qu’est-ce que c’est, le travail émotionnel ? » m’a demandé un de mes amis, occupé dans sa cuisine, en train de préparer le déjeuner pour nous - nous avions pris une pause après une matinée à travailler hors de sa maison à Manhattan.
Tandis que je tentais de lui expliquer le concept, j’ai vu ses sourcils se froncer avec la concentration puis peu à peu faire place à la confusion. Mon ami, un brillant trentenaire ingénieur en informatique, qui s’était révélé être un allié des causes féministes au cours de nos conversations passées, pensait clairement que ça allait trop loin.
« Pourquoi est-ce que le fait que les femmes fournissent un support émotionnel marche, cependant ? Peut-être que les gens aiment ça ? Peut-être que les femmes savent juste mieux le faire ? Pourquoi est-ce qu’on devrait en faire quelque chose de négatif ? »
Mon ami n’oserait jamais dire : “les femmes savent juste mieux faire le ménage”.
Ses questions trahissaient peut-être une certaine exaspération ressentie à mon égard. En toute honnêteté, il avait préparé tous les repas qu’on avait partagé au cours de notre amitié New Yorkaise sans jamais se plaindre.
« Pourquoi est-ce que les féministes doivent toujours transformer des trucs normaux en problèmes dont il faut débattre ? » a-t-il continué.
Pour lui, conceptualiser le travail émotionnel comme autre chose qu’un élément naturel, c’était être inutilement pointilleuse ; c’était faire tout un plat de quelque chose qui aurait mieux fait d’être laissé tel quel.
Mon ami n'oserait probablement jamais dire : « Oh, mais les femmes sont meilleures cuisinières », « les femmes savent juste mieux faire le ménage » ou « les femmes savent mieux s’occuper des enfants ». Et pourtant, sa suggestion selon laquelle peut-être que certaines femmes étaient « juste comme ça » - meilleures dans le secteur émotionnel - semblait être un argument contre lequel je me heurtais plus fréquemment quand j’amenais ce sujet de conversation sur la table.
Mais cette vision essentialiste ne se tient pas théoriquement.
En 2005, dans un article académique novateur où elle a pris en compte les informations de 355 parents employé.es et marié.es, la sociologiste Rebecca Erickson a découvert que non seulement les femmes s’occupaient du plus gros du travail relatif à l’émotion dans le foyer, en plus des soins des enfants et des tâches ménagères, mais aussi que c’était lié à la construction genrée, et non au sexe.
« Cette recherche montre notamment que la propension accrue des femmes à s’adonner au travail émotionnel n’est pas relatif à leur sexe mais plutôt à leur genre et à la position qu’elles ont occupée au sein de la famille et des groupes d’ami.es, au sein de la société. », explique Collett.
C’est un rôle auquel nous nous sommes simplement habitué.es : la femme comme gestionnaire des émotions, les projetant dans ce que Collett nomme « la seconde journée de travail ».
Dans la chambre à coucher aussi, les femmes sont supposées gérer les émotions et les sensibilités de leurs amants masculins.
Dans un article récent du Guardian, Alana Massey parle de l’inégalité sexuelle constante qui existe dans ce monde soi-disant post libération sexuelle. Peut-être qu’on est lentement arrivé à accepter l’idée que les femmes peuvent coucher comme elles veulent, mais le sex positivisme n’a pas du tout été suivi par des conversations répandues sur le type de sexe dont les femmes ont besoin et veulent afin d’être comblées.
On peut donc aussi penser au fait que les femmes ressentent le besoin de feindre l’orgasme non seulement comme la conséquence d’une société qui perçoit toujours l’acte sexuel comme centré sur les hommes, mais aussi comme une manière pour les femmes de répondre avant tout aux besoins de l’ego masculin.
Une étude publiée en 2011, rassemblant les informations de 71 femmes hétérosexuelles sexuellement actives, a révélé que tandis que les femmes rapportent généralement expérimenter l’orgasme (surtout durant les préliminaires), 79% d’entre elles feignent l’orgasme durant la pénétration vaginale plus de 50% du temps (25% des femmes interrogées feignaient l’orgasme 90% du temps).
L’étude a trouvé que 66% de ces femmes feignant l’orgasme (ou faisant des « vocalisations copulatoires », comme l’a décrit l’étude) ont dit le faire afin d’accélérer l’éjaculation de leur partenaire. Et même plus précisément, 92% de ces femmes ont dit qu’elles sentaient très fortement que cette technique boostait l’estime que leur partenaire avant d’eux-mêmes, ce qui était la raison pour laquelle 87% d’entre elles le faisaient en premier lieu.
***
Sara Thompson, une professeure devenue avocate d’affaires au début de la trentaine, est dans une relation amoureuse par tous les aspects très égalitaire.
Son mari et partenaire depuis 10 ans est un chercheur brillant, administrateur et professeur dans une Université Ivy League (prestigieuse). Ensemble, iels partagent une vie remplie d’arrangements formels et informels qui maintiennent leur relation saine et apparemment égale vue de l’extérieur.
Mais lorsque Thompson parle du travail émotionnel et des efforts quotidiens dans l’organisation du foyer qui vont avec sa relation romantique, des disparités commencent à émerger.
Après une éducation où elle était réprimandée dès qu’elle prenait trop de place, elle est devenue une personne qui est constamment, chroniquement en train de porter attention à ce qui l’entoure.
« Aujourd’hui, je suis une personne qui est très attentive et consciente du volume de ma voix, de la présence de mon corps dans l’espace public, du niveau de confort des gens qui m’entourent », explique-t-elle.
La plupart de ce qu’elle dit faire n’est pas simplement le ménage et l’entretien, mais est étroitement lié à ça. Ça inclut la pensée et la planification :
« Accrocher des choses aux murs, mettre les photos dans des cadres, penser à acheter ou non des nouveaux draps parce que les vieux s’abîment, penser au moment où on va dîner, penser à ce qu’on va manger. »
Et ce n’est pas juste que Thompson fait le dîner, c’est qu’elle prévoit le menu du dîner (qu’est-ce qu’il aimerait manger ?), et pense au moment où ils vont dîner - le genre d’attention qui passe inaperçue. « Ça m’énerve vraiment d’avoir à penser à ça. Ce n’est pas juste, c’est éprouvant pour moi », dit-elle.
La contraception est un autre problème. « Je suis celle qui doit faire toute la recherche pour lui, et qui doit lui expliquer. ‘Combien de temps ça prendra pour que tu tombes enceinte après le DIU ?’ me demande-t-il. ‘Eh bien, pourquoi est-ce que tu ne prends pas le temps de rechercher ça toi-même si tu penses qu’on va avoir des enfants ensemble ?’ »
Il en va de même pour les petits détails de la vie quotidienne. « Il cherche un truc. Tu as vu ma lime à ongles ? Il regarde dans le placard et dit qu’il ne la voit pas. C’est là. ‘Où est-ce qu’on range les torchons de cuisine ?’ me demande-t-il encore et encore. Après la troisième ou la quatrième fois, ce genre de truc doit être appris. »
Elle continue : « Cela me laisse entendre qu’il y a un détachement du foyer que je n’ai pas le luxe de vivre. Parce que si c’était le cas, notre vie quotidienne serait un cauchemar. Alors je prends ce rôle. Ce n’est pas mon moi authentique, mais je n’ai pas le choix », dit-elle.
Alors Thompson choisit ses combats (comme tout le monde, non ?), et la question demeure - si nous sommes socialiséEs depuis l’enfance à être comme ça, est-il possible qu’on sachent vraiment mieux le faire, même si la nature ne nous a pas créées ainsi ? Devrions-nous juste nous taire et continuer dans cette voie parce que le monde cesserait probablement de tourner si on ne le faisait pas ?
Où est-il temps de commencer à aussi oublier les anniversaires, d’arrêter de crier l’extase pour de faux, et de demander une rémunération adéquate et formelle pour le travail émotionnel qu’on apporte sur notre lieu de travail comme un talent ?
Alors ça, ce serait probablement une révolution qui remuerait le patriarcat jusqu’au trognon.